Au carrefour des mondes, avec le primo-romancier Walid Hajar Rachedi
Publié le :
Franco-Algérien, Walid Hajar Rachedi livre, avec Qu’est-ce que j’irai faire au paradis ?, un premier roman prometteur. Mi-autofiction, mi « road-novel », ce livre raconte la quête initiatique de son personnage central, engagé sur les chemins du monde qui le conduisent de Paris à Londres, en passant notamment par le Maghreb et Le Caire. Double de l’auteur, Malek se situe au carrefour des civilisations et se veut représentatif des heurs et malheurs de la jeunesse française de confession musulmane.

« Je pense que le désir d’écrire est venu au départ du fait que j’avais l’impression d’observer les choses de manière décalée. J’ai grandi en France de parents algériens. J’étais un transfuge de classe : je suis né dans un milieu populaire, puis je suis allé pour mes études à Paris où j’ai vu d’autres mondes. Ce décalage constant, j’avais l’impression qu’il n’était pas reflété dans la littérature que je pouvais lire. Je me suis mis à écrire parce que j’avais l’impression que le livre que je voulais lire n’existait pas. »
Ainsi parle Walid Hajar Rachedi, conteur des mondes décalés. Walid Hajar Rachedi est un primo romancier de talent, comme en témoigne le beau roman que ce quarantenaire vient de faire paraître aux Éditions Emmanuelle Collas. Qu’est-ce que j’irai faire au paradis ? est, en effet, un premier livre ambitieux, percutant, à mi-chemin entre autofiction et travelogue, qui nous entraîne loin de la cité des Peupliers à Stains où l’intrigue du récit prend sa source
Quête de sens
Double de l’auteur, le héros-narrateur du roman, Malek Bensayah est d’origine franco-algérienne. Hanté par les égarements aux conséquences tragiques de sa jeunesse, il se sent à l’étroit dans sa banlieue où le ciel est bas et l’avenir passablement bouché. C’est en allant voir à Lille un cousin fraîchement débarqué d’Algérie que Malek fait la connaissance d’Atiq, un jeune Afghan en exil, à la recherche de son frère jumeau qui a rejoint les talibans.
Secoué par le récit de la lente descente de l’Afghanistan dans l’enfer de la terreur et du fondamentalisme religieux, Malek décide d’aller voir le monde de ses propres yeux. Sa quête identitaire le conduira jusqu’à Londres multiculturel, en passant par Madrid, Séville, Grenade, Tarifa, Tanger, Casablanca, Oran, Alger, Bejaia, Annaba, Tunis, Sfax, Tripoli et le Caire. Un long périple, qui sera riche en rencontres et découvertes sur le sens de la vie et de la mort, sur les enjeux de la spiritualité dans des sociétés en quête de sens.
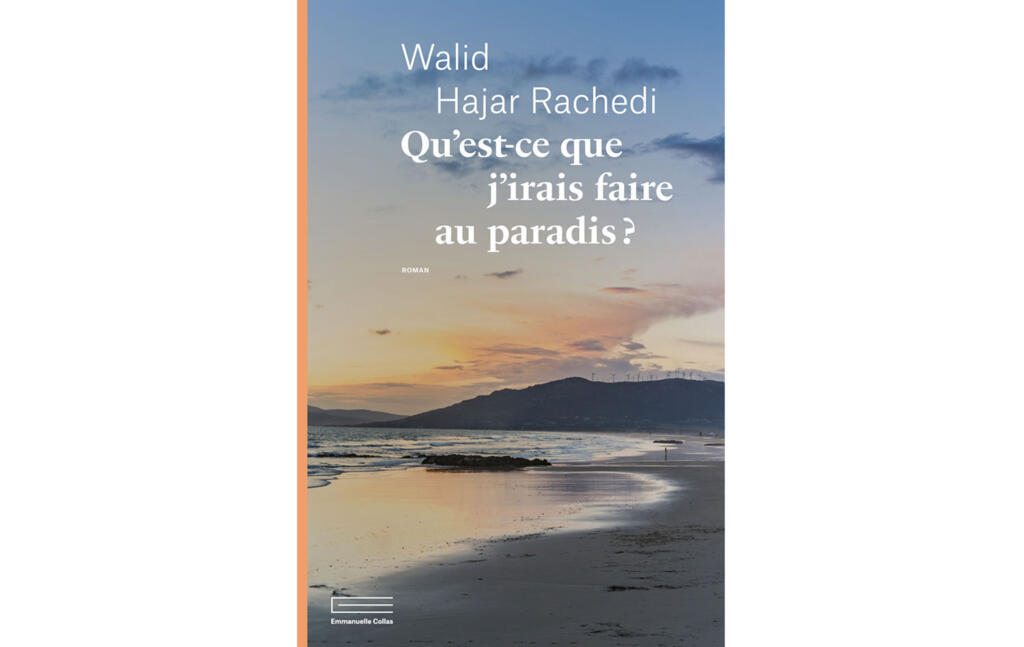
Revenant sur l'histoire du livre, l'auteur explique que pour lui, le périple de son personnage est moins motivé par « une quête identitaire que par une quête mystique et existentielle». Et de poursuivre : « Le voyage de Malek se termine en Égypte pour la partie qui se passe dans le monde arabe et ensuite il va à Londres qu’on peut considérer la vraie fin du voyage, quand il se confronte à ce monde multiculturel qui se présente comme un modèle alternatif à la ville occidentale dans laquelle les identités multiples sont mieux acceptées. Avec le personnage de Malek, ce que je voulais faire, c’est surtout créer un personnage qui reste ancré dans sa foi, qui se pose des questions existentialistes, qui ne rejetait pas du tout ni la France ni l’Occident, mais qui trouvait sa force ailleurs, dans une quête mystique. Pour moi, c’était aussi de montrer la réalité des jeunes Français de confession musulmane. »
L'Afghanistan déchiqueté
D’autres histoires viennent se greffer à la quête de Malek : celle de la belle Anglaise Kathleen, rencontrée sur la route de Tanger et dont le narrateur va tomber éperdument amoureux, l’histoire de Jeffrey, le père de Kathleen, un humanitaire qui se démène par idéalisme dans l’Afghanistan déchiqueté par les bombes américaines. Le parcours de cet homme croisera celui des deux frères islamistes radicalisés, Atiq et Wassim, qui feront irruption dans la vie de Malek de manière pour le moins dramatique. La convergence de ces différentes trajectoires constitue le fil narratif central du roman de Walid Hajar Rachedi, situé résolument au carrefour de l’intime et du public.
Explication de texte par le romancier en personne : « Un grand thème qui m’obsède, c’est la question du libre arbitre versus le destin. L’histoire de l’Afghanistan est fascinante de ce point de vue-là parce que c’est un pays qui a résisté à tous les impérialismes, toutes les occupations, et en même temps qui a été volé de son destin. Moi, j’ai trouvé que dans le destin de ce pays, il y avait quelque chose de très romanesque, presque un personnage en tant que tel, incarné par les personnages d’Atiq et de Wassim. En fait ce que je voulais dire par là c’est que l’endroit où on va naître, la manière dont les événements historiques vont se dérouler, vont avoir une influence très grande sur le destin des personnages et tout l’enjeu va être : qu’est-ce qu’on fait de ces circonstances-là ? Ca c’est la question du choix. Comme on voit, notamment dans l’épilogue du roman, chacun des personnages va se positionner de manière assez radicale par rapport à ça. On est dans des logiques intimes, certes, mais aussi géopolitiques qui sont très complexes. »
« Il n’y a que la voix de celui qui raconte qui change »
On ne sort pas indemne de ce récit de quêtes et de pertes, avec pour cadre la guerre des civilisations. Il y a quelque chose de Guerre et paix tolstoïenne dans ce roman qui mêle avec brio la petite et la grande histoire. Il y a aussi du Camus et du Richard Wright dont l’auteur avoue s’être inspiré, tout en rappelant par personnage interposé que « toutes les histoires ont déjà été racontées, il n’y a que la voix de celui qui raconte qui change ».
Une phrase révélatrice de l'art poétique de Walid Hajar Rachedi, comme il l'explique: « Cette phrase-là traduit ma propre interrogation d’auteur. Quand vous commencez à écrire, surtout quand vous êtes dans une position comme la mienne, Français d’origine algérienne qui a grandi dans un milieu populaire, est-ce que moi je vais réussir à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui décrit les réalités de manière un peu différente ? Tout au début, en tant qu’auteur, on a un peu le fantasme d’essayer de trouver une sorte d’histoire hyper-originale, avec des rebondissements, avec des trucs incroyables, etc. C’est vrai qu’en avançant dans l’écriture, je me rends compte que toutes les grandes histoires sont toujours un peu les mêmes. On fait des cercles autour du même récit. Finalement, quand vous lisez la Bible, le Coran, même les grands mythes, les histoires ont déjà été racontées. Ce qui change, c’est la manière de les traiter, c’est le point de vue, c’est la sensibilité, c’est la voix. »
Cette voix, elle n’a pas été facile à trouver, avoue le romancier. Mais elle est bien là, cette musique grave, propre à Walid Hajar Rachedi, qui nous rappelle la cohérence tragique du monde.
Qu’est-ce que j’irais faire au paradis ? par Walid Hajar Rachedi. Éditions Emmanuelle Collas, 18 euros.
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne