«L’Odyssée des fourmis», d'Audrey Dussutour et Antoine Wystrach
Publié le :
Le Livre France de la semaine s'intéresse à un monde bien plus varié que ce que l'on croit : celui des fourmis. C'est le fruit d'années d'études de deux chercheurs à travers le monde : un voyage dans ce qu'ils qualifient de chaos organisé. Explications avec l'un des auteurs, Antoine Wystrach.

Antoine Wystrach, vous êtes éthologue, autrement dit spécialiste du comportement des insectes, et vous cosignez avec Audrey Dussutour L’Odyssée des fourmis, paru chez Grasset. Pour être exact, c’est l’odyssée d’une petite partie des 13 000 espèces de fourmis.
Exactement. On a donné un sous-échantillon de la variété du monde animal. Les insectes représentent une grande partie du monde animal. Les fourmis, en termes de biomasse, il y en a énormément. Après, on n’a pas fait 13 000 chapitres correspondant aux 13 000 espèces. On parle de 70 espèces dans le livre. Et au sein de ces 70 espèces, on ne présente que certaines des fourmis.
On a choisi de parler de celles qui sortent à l’extérieur du nid pour aller chercher la nourriture, parce que c’est là qu’elles se confrontent aux dangers du monde extérieur, et qui révèlent toutes leurs astuces et leur intelligence. Il y a eu beaucoup de recherches sur ces fourmis-là. Donc c’est un tout petit pourcentage des individus de cette colonie. Et pour ces individus-là, on ne parle que de certaines aventures. Donc, on n'a qu’un tout petit échantillon de la richesse du vivant.
Pour celles-là que vous appelez les « fourrageuses », aller chercher la nourriture, c’est un peu comme pour d’autres, débarrasser la fourmilière des poisons ou des plantes toxiques : c’est une tâche qu’on confie aux fourmis les plus âgées…
Généralement, la plupart des espèces font ça. C’est dehors que c’est dangereux. À l’intérieur du nid, ce n’est pas si dangereux. Si vous avez investi pour passer d’un œuf à une larve à un individu adulte, autant qu’elle rentabilise ce coup en travaillant dans la colonie sans risque. Une fois qu’elle est plus vieille, c’est là qu’elle peut risquer sa vie. C’est ça qu’a choisi l’évolution pour ces insectes. Donc, ce sont les vieilles qu’on envoie au casse-pipe.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes principalement intéressé aux fourrageuses ?
Les fourmis sont surtout connues pour leur organisation sociale dans le nid. C’est souvent ça qui revient. Or il y a aussi le côté incroyablement sophistiqué d’un individu dont on ne parle pas souvent. Et lorsque les fourrageuses sortent en solitaire, ou bien dans le groupe, quand on observe les stratégies individuelles ; elles s’expriment pleinement à l’extérieur du nid.
Donc, ce sont des histoires qu’on n’a pas l’habitude d’entendre. Et les gens sont surpris d’apprendre qu’un individu peut mémoriser son environnement, il analyse, il a un cerveau… Tout cela, ce sont des choses qu’on ne sait pas trop.
Vous décrivez une scène de chasse : « mandibules écartées, corps aplati, antennes pointées… » Comment est-ce qu’on observe quelque chose d’aussi petit ?
Le livre est un hommage à tous ces naturalistes qui sont en train de disparaître. C’est un style de recherche qu’on ne voit plus trop souvent. Depuis à peu près 200 ans, il y a des gens qui observent les insectes en détail (il y a des écrits qu’on a retrouvés). Effectivement, c’est surtout de la patience. À l’époque, c’était associé aussi avec du dessin, des croquis, des postures, pleins de détails. C’est incroyable.
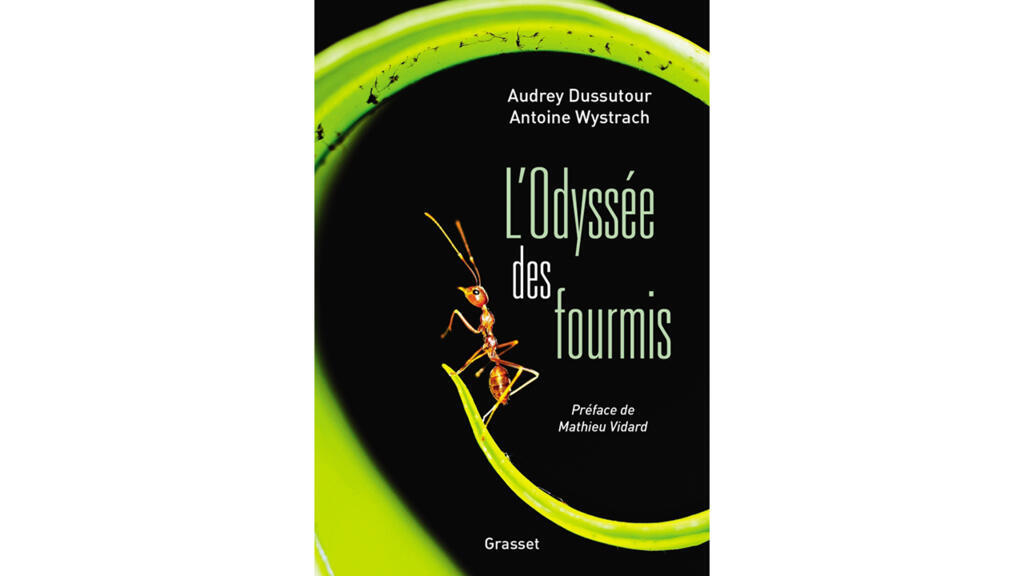
Vous parlez des naturalistes. On a l’impression que vous regrettez qu’il n’y ait plus ce goût pour la recherche naturaliste…
La mode de la recherche du moment est très centrée sur la technologie, les outils, le big data, les choses comme ça. Il faut toujours qu’il y ait quelque chose des neurosciences et des modélisations. Du coup, la recherche naturaliste est vue comme vieillotte, alors qu’en fait, c’est une source d’inspiration absolument monumentale. C’est dommage que ça disparaisse.
On y apprend que lorsqu’une fourmi meurt, elle est immédiatement rangée à l’écart des autres, que pour se déplacer, elles peuvent créer un pont suspendu ou un tunnel assez solide. Qu’est-ce qui vous épate le plus chez les fourmis ?
Je pense que c’est la diversité qu’on observe d’une espèce à l’autre. Des mondes complètement différents. Chaque individu se crée un univers à travers ses histoires et c’est quand on prend la mesure de cette diversité qu’il y a entre nos pieds… Donc, c’est une mise en abyme.
Il y en a certaines qui sont dans un monde très visuel qui se déplacent à pas furtifs, des petits sauts, qui regardent autour le moindre mouvement pour se cacher derrière une feuille alors que vous avez d’autres espèces qui sont complètement aveugles, très olfactives, à écouter leurs congénères pour faire ces longues pistes chimiques. Donc, imaginez, c’est un monde intérieur complètement différent. Quand on prend la richesse de tous ces micro-mondes, je pense que c’est ça au final qui m’épate le plus.
C’est ça qu’on a dit au début. Il y a 13 000 espèces et selon les espèces, on peut avoir des types d’organisation complètement différents.
Complètement. Le point commun entre ces fourmis, hormis leur histoire évolutive qui a quand même 100 millions d’années, c’est qu’elles font toutes des sociétés. Contrairement aux guêpes ou aux abeilles où on trouve des solitaires, apparemment toutes les espèces de fourmis sont en société. Mais il y a des sociétés de deux individus et des sociétés de vingtaines de millions d’individus. Vous imaginez bien que ce n’est pas la même chose.
Vous parlez également de chaos organisé… Et vous dites que si on devait comparer à l’homme ce qui motive cette contribution commune des fourmis, ça pourrait être Wikipedia… Ou chacun, sans qu’il y soit obligé, sans que ce soit demandé par un chef, apporte sa petite pierre à l’édifice.
Voilà sans que ce soit planifié ou organisé par un chef effectivement. Chacun suit une petite règle, et ce sont ces petites règles ensemble qui font émerger quelque chose qui est supérieur à la somme de ces petites règles. Wikipédia, c’est un bon exemple. Il n’y a pas eu besoin de diriger quels articles vont où… Cela s’auto-organise avec des gens qui font finalement des choses assez différentes. Cela crée un tout supérieur à ce que chaque personne aurait pu faire individuellement.
Un exemple : si vous regardez des fourmis qui sortent en solitaire pour chercher de la nourriture. Des chercheurs se sont amusés à traquer le déplacement de tous les individus qui sortaient de la colonie. Ce qu’on voit, c’est que chaque individu va dans un territoire qui peut être à 30 mètres du nid et va chasser dans ce territoire-là. Et quand on regroupe tous les territoires, cela crée une mosaïque qui recouvre parfaitement l’espace autour du nid. Comment organisent-elles cela ? Ce n’est pas évident.
Une des petites règles simples, c’est que quand une fourmi trouve à manger, elle tend à retourner à cet endroit-là. Donc, les endroits où il y a déjà beaucoup de fourmis, les nouvelles fourmis ne vont pas trouver beaucoup à manger. Il y a moins de nourriture. Mais aussi : même si elles sont de la même colonie, une fourmi habituée à aller dans un territoire, si elle voit une de ses consœurs naïves qui se balade ici, elle va tendre à être un peu brutale et lui dire : va plus loin. Automatiquement, avec ces petites règles, cela va recouvrir l’espace autour du nid. Voilà, c’est un exemple de chaos organisé.
Qu’est-ce que sont les fourmis kamikazes ?
Vous retrouvez ça chez les abeilles… le sacrifice pour la colonie. Ce sont des individus qui au final vont avoir des glandes mandibulaires hypertrophiées, pleines de poison, qu’elles sont capables de détendre, ce qui fait éclater leur corps et qui fait gicler de l’acide sur l'ennemi, et ça peut être très efficace. Une fourmi qui se sacrifie peut tuer 3 à 4 individus et demi. Au bout du compte, le bilan pour la colonie est positif.
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne