Présidentielle française: désendettement, le grand oublié de la campagne
Publié le :
La question de la dette publique a été reléguée au second plan par le Covid-19 et maintenant par la guerre en Ukraine. Le désendettement reste pourtant un enjeu primordial pour l'économie française.

En 2012, quand l’Europe pansait encore les plaies de la crise de la dette, les finances publiques étaient un sujet majeur de la campagne. C’était aussi le cas en 2017. Avec, d’un côté, les candidats plutôt à droite partisans du désendettement et de la rigueur budgétaire, et de l’autre, plutôt à gauche, les keynésiens avec un programme de fortes dépenses publiques. Pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, l’endettement de la France a empiré, passant de 97% à 113% du PIB, selon la Cour des comptes, et étonnamment le sujet a quasiment disparu des radars.
Le Covid-19 a-t-il aggravé l’endettement ?
Oui et non. Oui, parce qu’il a fallu s’endetter davantage pour financer la lutte contre la pandémie et ensuite pour éviter le naufrage économique. Mais non, parce que la politique du quoi qu’il en coûte n'est pas l'unique cause de la dégradation des comptes publics. Le déficit structurel, hors dépenses Covid-19, a doublé depuis 2019.
Dans l'esprit des électeurs, ces dépenses exceptionnelles financées par de nouvelles dettes marquent pourtant une rupture quasi « idéologique » : les Français découvrent avec stupeur que l’État peut encore s’endetter sans s'effondrer, contrairement au discours alarmiste tenu, entre autres, par François Fillon lorsqu’il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy.
Et aujourd’hui, c'est encore le « dépenser plus » qui est à l'ordre du jour, puisque la guerre en Ukraine exige de nouvelles dépenses massives : dans le soutien aux ménages éreintés par la hausse du prix du gaz, de l’électricité et maintenant du carburant. L’État devra y consacrer des dizaines et des dizaines de milliards d’euros. Dans la défense, le budget pourrait passer de 2% à 3% du PIB.
Les règles de Maastricht sont-elles encore le curseur des finances publiques ?
Emmanuel Macron et Valérie Pécresse pour les Républicains promettent tous les deux de revenir à un déficit en dessous de la barre des 3% du PIB d'ici à 2027, comme le prévoit le pacte de stabilité et de croissance. Il faudrait rogner sur 70 milliards d'euros sur cinq ans pour y parvenir, selon l'institut Montaigne. Au vu de leurs propositions, les experts sont dubitatifs sur leurs engagements.
Dans l’entourage de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national susceptible d’arriver au second tour, on estime inutile de tenir compte de ces critères, puisque jamais aucun gouvernement français ne les a respectés. À gauche, on compte surtout sur l'assouplissement du pacte de stabilité qui a été mis entre parenthèse depuis l’émergence du Covid-19. Les dépenses liées à la transition énergétique pourraient être exclues du périmètre de calcul des déficits, propose le candidat écologiste Yannick Jadot.
Quels sont les défis budgétaires qui attendent le prochain gouvernement français ?
Il faudra trouver de nouvelles ressources pour financer la hausse des dépenses prioritaires devenues incontournables sur lesquelles tous les candidats s’accordent. Comme la transition énergétique et la défense, mais aussi la santé et l’école. Plus d’impôts, ce n’est pas le premier choix des prétendants à l’Élysée, la plupart souhaitent au contraire en supprimer.
Les candidats d’extrême droite veulent mettre fin à toutes les aides aux étrangers, qu’ils chiffrent entre 17 à 20 milliards d’euros. Une idée électoraliste jugée peu crédible, tout comme la baisse de la contribution au budget européen avancée par Valérie Pécresse.
Jean-Luc Mélenchon veut, lui, annuler la dette Covid-19. Enfin, la retraite à 65 ans est une piste proposée par Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, 64 ans pour Eric Zemmour, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon veulent revenir à la retraite à 60 ans.

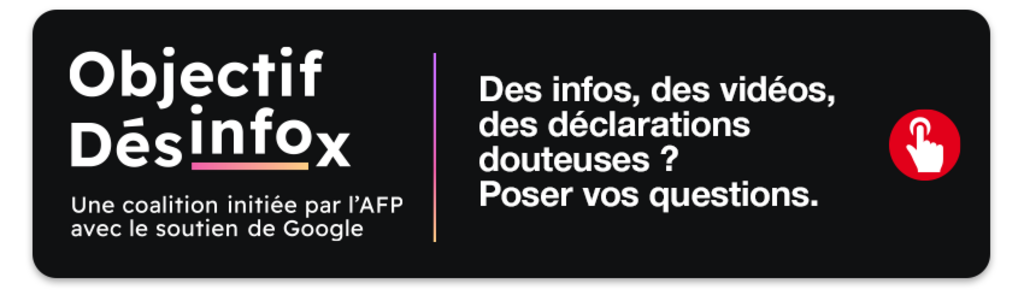
► EN BREF
La guerre en Ukraine va coûter au moins un demi-point de croissance à la France
Selon l'évolution du pétrole, la croissance sera amputée cette année de 0,5% à 1,1%, annonce la Banque de France. Elle table toutefois sur au moins 2,8% de croissance.
Le défaut de la Russie est imminent, selon le FMI
L'État est pourtant peu endetté, mais les sanctions le privent de l'accès à ses réserves en dollars, il ne sera donc pas en mesure de régler l'échéance due ce mercredi.
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne