Dans la chaleur et la poussière du Londres noir, avec Bernardine Evaristo
Publié le :
Lauréate du Booker Prize 2019 avec son magistral Fille, femme, autre, Bernardine Evaristo domine la littérature britannique du haut de son écriture délicieusement subversive. La parution en traduction française de Mr. Loverman, l’un des précédents romans de la Britannique racontant le « coming out » d’un dandy caribéen dans le Londres d’aujourd’hui, est une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir la plume aux mille talents de cette écrivaine militante de la cause noire.

« J’écris parce que je suis fondamentalement une conteuse. C’est ma raison d’être. C’est mon oxygène. Je ne sais pas ce que je deviendrais si je devais perdre un jour cette capacité qui me donne tant de joie d’imaginer des histoires, en m’inspirant des expériences et des récits de vie des hommes et de femmes qui m’entourent. C’est ce qui donne sens à mon existence. »
Ainsi parle Bernardine Evaristo, la grande dame des lettres britanniques. Avec neuf ouvrages à son actif, elle est l’auteure d’une œuvre impressionnante, résolument expérimentale, composée de romans en vers, récits féministes, romans de mœurs, « road novel » et d’un mémoire intitulé Manifesto, sa publication la plus récente. Son septième roman Mr. Loverman, qui vient de paraître en traduction française, est porté par cette écriture assurée, mêlant poésie et prose et explorant l’expérience de la diaspora noire, qui est devenue la marque de fabrique de cette auteure.
Née en 1959, de mère irlandaise et de père d’origine nigériane, Bernardine Evaristo a grandi à Woolwich, dans une banlieue ouvrière, au sud de Londres. Dans son récent mémoire, elle revient longuement sur son expérience de grandir au sein d’une famille métisse, à une époque où la discrimination raciale ne tombait pas encore sous le coup de la loi. La romancière se souvient que sa famille maternelle avait coupé les ponts avec sa mère, car celle-ci avait épousé un homme noir et que les carreaux des fenêtres de leur pavillon victorien étaient souvent cassés par les enfants du quartier qui prenaient un malin plaisir à lancer régulièrement des briques dans la maison, proférant des insultes racistes. L’hostilité des voisins avait conduit les parents Evaristo à interdire à leurs enfants de jouer dans la rue.
Scénariste, poète et romancière
Le salut de la jeune Bernardine viendra par le théâtre qu’elle a découvert à l’âge de 12 ans en accompagnant sa sœur à des répétitions dans une église désaffectée. Elle fera une formation de comédienne, avant de fonder sa propre troupe, le Théâtre des femmes noires, frustrée par la pénurie de rôles pour des comédiens de couleur sur les planches britanniques.
« Lorsque j’étais petite fille, c’est avec gourmandise que j’écoutais les histoires que mes parents me racontaient, se souvient-elle. Puis, quand j’ai grandi, j’ai fait du théâtre, qui est aussi une forme de « storytelling ». J’ai suivi une formation pour devenir comédienne, avant de fonder à l’âge de vingt ans une troupe de théâtre pour femmes. Mon entrée dans l’écriture date vraiment de cette époque. Chemin faisant, j’ai découvert combien écrire comptait pour moi. »
Scénariste pour le théâtre, mais aussi poète, Bernardine Evaristo a publié ses premiers livres dans les années 1990 : une pièce de théâtre qui a été jouée au Royal Court Theatre, un recueil de poèmes et son premier roman Lara, un récit autofictionnel en vers, remarqué par la critique. Mais c’est seulement à soixante ans, en 2019, avec son huitième roman que cette écrivaine talentueuse s’est fait réellement connaître du grand public en remportant le prestigieux Booker Prize, conjointement avec la Canadienne Margaret Atwood. Roman choral en vers libres, racontant la vie des femmes marginalisées de la société britannique, essentiellement noires, Fille, femme, autre fit l’événement à la soirée de l’attribution du Booker en obligeant le jury à rompre avec la tradition et partager le prix entre deux lauréats, en l’occurrence deux lauréates.
Première femme noire à recevoir le Booker Prize, Bernardine Evaristo admet volontiers que ce prix a été un tournant dans sa carrière littéraire. Cette reconnaissance a vu son lectorat se multiplier de manière exponentielle, avec 1,5 million d’exemplaires de son roman primé vendus depuis dans le monde anglophone. Il a aussi été traduit en 29 langues étrangères, dont le français. Selon l’agent de l’auteure interrogée par le New York Times, le Booker a fait voler en éclats le mythe rampant, dans l’édition britannique, selon lequel il n’y avait pas de public en Angleterre pour des romans avec des protagonistes noirs.
Pour l’auteure de Fille, femme, autre, l’explosion de son lectorat est allée de pair avec la consécration institutionnelle. Depuis novembre 2020, Bernardine Evaristo dirige la Royal Society of Literature, devenant la première femme noire à présider à la destinée de cette institution bicentenaire, longtemps dominée par des écrivains de souche. Professeure de l’écriture créative à l’université Brunel de Londres, elle a été nommée, à la suite de l’attribution du Booker, à la tête de son alma mater, le Rose Bruford College of Theatre and Performance, où elle a fait ses études de théâtre dans les années 1980. Malgré le succès, la romancière reste militante dans l’âme et profite de ses positions institutionnelles pour promouvoir des jeunes talents ainsi que des écrivains issus de la diversité qui ont infusé une nouvelle vitalité dans la littérature anglaise.
« Un roi dans son château »
L’écriture d’Evaristo est le produit de son imaginaire pluriel, à la croisée des chemins entre l’Angleterre, l’Afrique et les Caraïbes. Ses romans s’inscrivent dans la tradition de la « Black British writing », dont les bases ont été jetées par des écrivains issus de la première génération de migrants caribéens qu’on appelle la « Windrush generation », en référence au nom de leur bateau. Sam Selvon, V.S. Naipaul, Caryl Philips, Zadie Smith, Ben Okri, Kwame Kwei-Armah, Linton Kwesi Johnson, sont quelques-unes des plumes issues de cette tradition de littérature noire qui a donné une visibilité à la diaspora africaine d’Angleterre en racontant dans leurs pages les heurs et malheurs de cette population trop longtemps ignorée par la littérature.
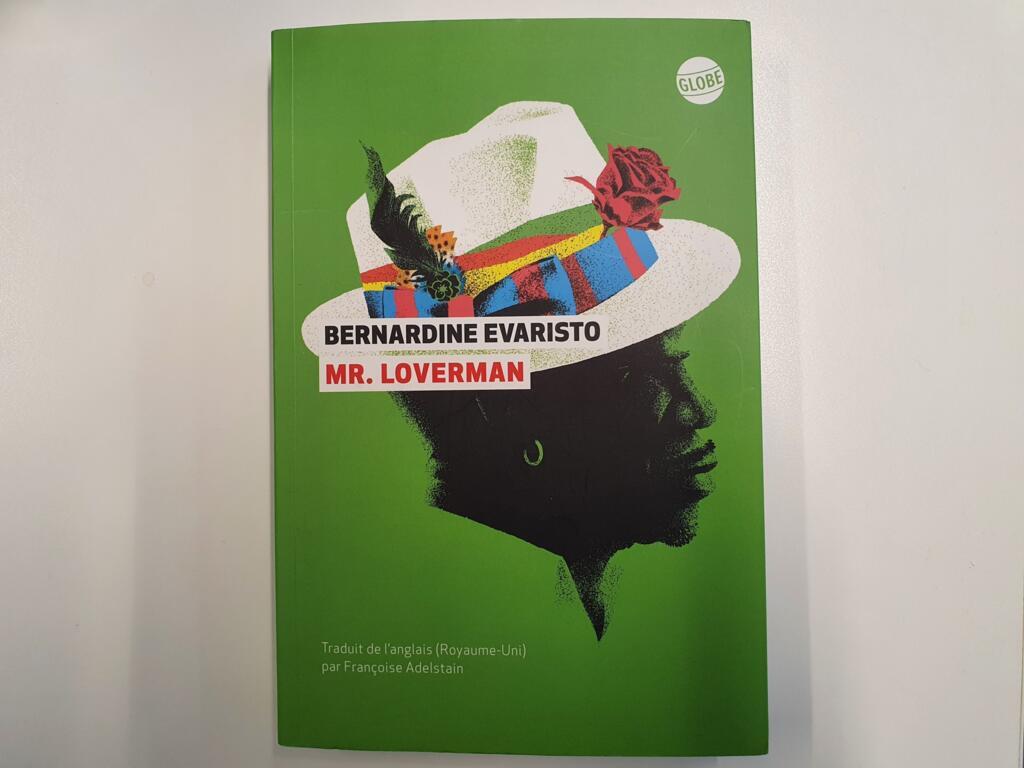
Le projet de donner la parole à tous ceux qui sont bannis des pages de la littérature de la mainstream anime toute l’œuvre de Bernardine Evaristo. Son dernier roman à paraître en français, Mr. Loverman, ne déroge pas à la règle. Au cœur du récit, un dandy caribéeen vieillissant qui décide de braver « le gouffre de l’aliénation sociale » à l’âge de 74 ans, en rompant avec sa femme pour aller partager la vie de l’homme dont il est amoureux depuis l’adolescence. Avec empathie et ironie subtile, l’auteure brosse un portrait attachant de son protagoniste, à la fois déchiré entre ses allégeances, familiales, sexuelles, et pétri de contradictions liées à son statut de patriarche de sa famille, « un roi dans son château ». Il y a du Roi Lear et du Naipaul, dans ce personnage de héros essentiellement tragique.
« Ce roman raconte l’histoire d’un homme qui est incapable de s’assumer en tant qu’homosexuel et doit subir les conséquences qu’entraîne sa double vie, explique l’auteure. C’est un récit sur la tromperie, mais aussi d’une certaine façon sur la persécution car le protagoniste n’a jamais osé vivre ouvertement son homosexualité, ni dans l’île caribéenne d’Antigua où il a grandi, ni en Angleterre où la loi concernant les pratiques homosexuelles n’a été libéralisée qu’en 1967. Il a donc dû toujours cacher son identité sexuelle, pas à lui-même, car depuis ses années caribéennes il entretient une relation régulière avec son amant attitré, Morris. Mais il a caché la vérité à sa femme et à ses proches. Quel sera le prix à payer s’il décide d’assumer son homosexualité au grand jour ? C’est la question qu’explore ce roman. »
À la fois comédie de mœurs et roman militant et experimental, Mr. Loverman frappe aussi par l’inventivité de son écriture qui passe du présent au passé, de la narration omnisciente au récit dialogué entre narrateur et personnage (de l’épouse), de la prose au format poétique sans point final ni majuscules. L’auteure aime définir ce style de « fusion fiction », une sorte de fusion narrative et stylistique qui lui permet de se libérer des conventions romanesques et d’incarner puissamment ses personnages, en l’occurrence l’épouse du personnage principal, à la fois victime de sa propre naïveté et de la situation dans laquelle elle se retrouve.
Un choix de style dicté par la narration, si l’on en croit la romancière : « Dans la première version de Mr. Loverman, j’avais fait le choix d’une narration simple, uniquement en prose où le lecteur prend connaissance des souffrances de l’épouse du protagoniste à travers les yeux de ce dernier. J’ai ensuite réécrit dans une forme poétique les passages relatant le triste sort de cette femme, Carmel, cinquantenaire, mariée à un homme de 74 ans, qui lui fait subir moult humiliations. Qui plus est, elle ne sait pas que son mari est gay et qu’il mène une double vie. Dans ces conditions, laisser l’homme raconter l’histoire de sa femme posait des problèmes de cohérence narrative que j’ai corrigés en insérant dans le livre des chapitres où la narration épouse le point de vue de Carmel. Ces passages rédigés dans un format poétique étaient ma façon de faire entendre la voix de Carmel. »
Longtemps après qu’on a refermé le roman, la voix de Carmel continue à résonner dans nos oreilles. Héroïne malgré elle, percluse de doutes et de désespoirs, elle est annonciatrice des douze voix de femmes dans Fille, femme, autre, roman, qui a fait la renommée littéraire de « Mrs Evaristo ».
Mr. Loverman, par Bernardine Evaristo. Traduit de l’anglais par Françoise Adelstain. Editions Globe, 302 pages, 23 euros.
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne