La quête de la langue perdue et retrouvée, avec Beata Umubyeyi Mairesse
Publié le :
Lauréate 2020 du Prix des Cinq continents de la Francophonie pour son premier roman, la Franco-Rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse s’est imposée comme l’une des voix majeures de la littérature africaine contemporaine. Elle publie cet automne son deuxième roman, Consolée, qui raconte, à travers la dérive mentale et physique d’une vieille dame énigmatique à la peau cuivrée, la colonisation et ses séquelles dramatiques sur les vies.

La question de la cohabitation des langues est au cœur de l’œuvre de la romancière franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse. Cette question occupe une place également importante dans la vie de l’écrivaine. Celle-ci avait raconté, à l’occasion de la parution de son premier roman Tous tes enfants dispersés, comment pendant le génocide de 1994, elle avait réussi à donner le change aux tueurs qui traquaient les tutsis, en faisant semblant de ne pas comprendre le kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda. Ce mensonge lui avait sauvé la vie et lui a permis de se reconstruire en France après avoir fui son pays natal.
Auteure aujourd’hui d’une œuvre remarquée, composée de recueils de poésies, de nouvelles et de deux romans, Beata Umubyeyi Mairesse aime à dire qu’elle a réparé son mensonge à travers son écriture qui donne à sa langue maternelle la place fondatrice qui lui revient. Son œuvre se caractérise, en effet, par le souci constant de l’auteure de féconder sa langue d’écriture, le français, avec la musicalité et la luxuriance poétique du kinyarwanda.
Avec son nouveau roman, Consolée, qui vient de paraître, l’auteure va encore plus loin, faisant de la quête de la langue maternelle l’enjeu même de sa geste romanesque. Le kinyarwanda, perdu et retrouvé, devient ici en quelque sorte un protagoniste du livre, au même titre que les personnages. « Vous avez tout à fait raison, confirme l’auteure. C’est un protagoniste. Quand on est écrivain et écrivaine, la langue n’est pas qu’un matériau. Pour moi, c’est un compagnon de tous les jours. J’ai deux compagnons, le français et le kinyarwanda, deux amis avec lesquels je chemine au quotidien. C’est dans le français que j’ai appris à lire et à écrire. C’est la langue par laquelle je suis entrée dans la littérature. C’est le français qui m’a choisie plus que moi qui l’ai choisi. Mais par contre, je n’ai pas abandonné, chemin faisant, le kinyarwanda qui a toujours irrigué mon imaginaire et qui est l’un des piliers de mon identité. »
Pilier de l’identité
Pour Consolée/Astrida aussi, personnage éponyme du nouveau roman de Beata Umubyeyi Mairesse, la langue, les mythologies de la terre natale rwandaise constituent les piliers de son identité. À 72 ans, Consolée, connue de ses proches sous son nom européen d’Astrida, est une vieille dame énigmatique et belle, à la peau cuivrée. Au moment où les lecteurs font sa connaissance, elle est veuve et en train de mourir dans un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), quelque part dans le sud-ouest de la France. Atteinte d’une maladie neurodégénérative, elle se rappelle peu de choses de son passé récent, mais son esprit est envahi par les souvenirs de son enfance.
Consolée n’a pas beaucoup d’amis parmi les résidents de la maison de retraite et elle passe l’essentiel de son temps à se promener dans le jardin de l’établissement, à regarder passer les oiseaux dans le ciel. Elle semble attendre un signe. Dans une autre vie, son grand-père ne lui avait-il pas promis de lui envoyer ses bénédictions par l’entremise du Sakabaka, l’oiseau totem de sa communauté ? La suite de l’histoire, c’est l’auteure qui la raconte : « Cette femme est atteinte de maladie d’Alzheimer et au fur et à mesure que sa mémoire s’efface, le français disparaît et fait place à une autre langue dont tout le monde ignore l’origine dans l’établissement et c’est une autre femme qui elle est venue en stage dans cette institution, stage d’art-thérapie, qui va lentement exhumer l’histoire de la dame âgée, Astrida. Et de l’histoire de Consolée, en la suivant, elle va arriver à l’histoire de la colonisation belge en Afrique. Une époque où les enfants métis étaient placés dans des orphelinats bien que leurs parents soient encore vivants. »
Une nostalgie sans fin
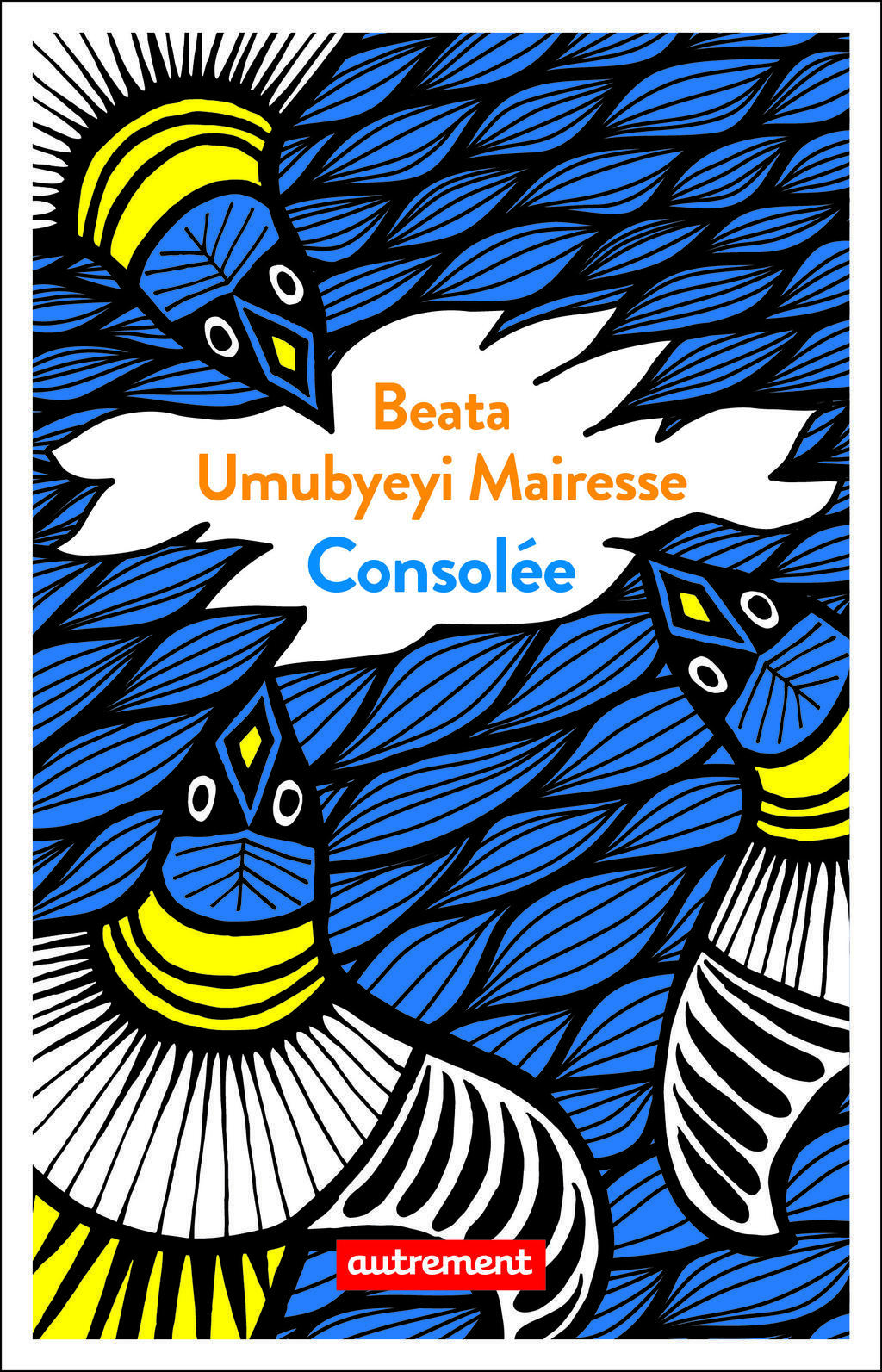
Consolée était née au Ruanda-Urundi, nom de la région à l’époque de la colonisation. Raconté en alternance avec sa vie à l’Ehpad, le récit des origines de la protagoniste est une histoire poignante, faite d’abandons, d’arrachements et de nostalgie sans fin. Victime des lois cruelles de séparation des races, Consolée avait été arrachée à sa mère à l’âge de sept ans et confiée à l’orphelinat colonial pour enfants métis de Save (Rwanda), géré par des bonnes sœurs. Au début, sa maman venait la voir les dimanches, comme elle y avait droit, avant d’interrompre la pratique, brisant à jamais le cœur de l’adolescente.
L’une des scènes les plus poignantes du roman est celle où l’on voit la vieille dame s’accrocher à une stagiaire sénégalaise de l’Ehpad qui l’a prise en affection. Consolée la tient par les hanches et lui parle en kinyarwanda, la langue de son enfance. « Je veux du lait, maman », implore-t-elle, confondant dans sa démence la stagiaire noire avec sa mère. « C’est une enfant qu’on a déclarée orpheline alors qu’elle ne l’était pas, affirme l’auteure. Elle va grandir toujours avec la peur d’être abandonnée. Moi, je pense qu’elle souffre d’une peur fondamentale de ne pas être à sa place nulle part et d’être abandonnée. »
Entre le présent et le passé
Consolée est un roman bouleversant et poétique sur le manque, l’exil, la vieillesse. C’est aussi un roman sur l’histoire coloniale et postcoloniale mise en résonance à travers la rencontre de la vieille Consolée avec Ramata, la stagiaire quinquagénaire de l’Ehpad, d’origine africaine. La sororité qui naît entre les deux femmes conduit la Sénégalaise à déchiffrer le mystère des origines de l’aînée, mais aussi à se réconcilier avec sa propre histoire d’immigrée, s’inscrivant dans un continuum de luttes et de dominations. Car comme le rappelle la phrase de Nadine Gordimer mise en exergue dans les pages de garde de Consolée : « Le présent est une conséquence du passé. »
La principale originalité de ce beau roman est peut-être d’avoir raconté la dérive de sa protagoniste agonisante à travers la symbolique de la langue perdue et retrouvée. Métaphores des blessures de l’âme, ces dysfonctionnements de la parole et de la mémoire dont souffre Consolée sont aussi symptomatiques d’une crise de transmission entre les générations dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles.
« Qu’est-ce qui va se passer, s’inquiète l’auteure, si un jour nous ne pouvons plus communiquer avec nos enfants parce que nous ne parlons que la langue de notre enfance et que nos proches ne connaissent pas ? »
Consolée, par Beata Umubyeyi Mairesse. Éditions Autrement, 376 pages, 21 euros.
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne