La tragédie de l’exil: entretien avec Abdelaziz Baraka Sakin, romancier soudanais
Publié le :
Le Corbeau qui m’aimait est le nouveau roman sous la plume du grand romancier soudanais Abdelaziz Baraka Sakin. Exilé en Europe depuis la confiscation de ses livres par les autorités de son pays, il vit en Europe, entre l’Autriche et la France. Son nouvel opus fait partie d’une série de cinq récits mettant en scène les drames de la migration et de l’exil. Gagné par la folie et protégé par les corbeaux, son protagoniste Adam l’Ingiliz est un personnage somptueux, à mi-chemin entre le roi Lear shakespearien et les héros des récits merveilleux latino-américains. Avec sensibilité et empathie, l’auteur brosse le portrait de cet homme sorti des mythologies contemporaines de la migration, tiraillé entre l’attrait de l'ailleurs et l’amour de son pays natal perdu à tout jamais.

RFI: Abdelaziz Baraka Sakin, vous avez fui votre pays pour vous réfugier en Autriche, puis en France où vous avez obtenu l’asile politique et où vous vivez depuis plusieurs années. Comment avez-vous découvert la Jungle de Calais qui sert de cadre à votre nouveau roman ?
Abdelaziz Baraka Sakin: Vous savez, en tant que réfugié moi-même, il m’arrive de rencontrer d’autres réfugiés. Ils me parlent de la Jungle. C’est en les écoutant que je me suis dit qu’il fallait que j’aille voir cet endroit de mes propres yeux. J’ai sauté sur l’occasion, lorsqu’un jour une organisation chrétienne m’a appelé pour me demander si je voulais venir parler aux personnes vivant dans la Jungle. Je me suis rendu à Calais. J’y ai parlé aux migrants. Ils vivaient dans la misère et faisaient face à énormément de problèmes. Leur vie dans la Jungle est très compliquée. Mais ce qui m’intriguait surtout c’est de constater qu’ils voulaient tous poursuivre leur long périple, traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Pourquoi ? C’est cette question qui m’a poussé à écrire ce livre.
Cette question du « pourquoi » est au cœur de votre roman Le Corbeau qui m’aimait. Croyez-vous avoir trouvé la réponse ?
Voyez-vous, pour moi, lorsque j’ai fui mon pays et j’ai réussi à atteindre le premier endroit sûr, ce pays est devenu ma destination finale. Pourquoi devrais-je chercher un autre lieu sûr ? Mais ce n’est pas ainsi que pensent ces jeunes réfugiés de la Jungle. Bien qu’ils se retrouvent en France, un pays suffisamment sûr pour eux, où ils peuvent demander l’asile et trouver à peu près tout ce dont ils ont besoin pour survivre, ils veulent quand même s’engager dans une nouvelle aventure, qui risque d’être périlleuse. Ils peuvent y laisser leur peau. Mais ils prennent quand même le risque. En bavardant avec les intéressés, je me suis rendu compte que ces personnes étaient habitées par une ambition, un rêve plus grand que la simple recherche de sécurité : ils veulent accomplir quelque chose d’exceptionnel, donner un sens à leur existence. C’est aussi l’histoire de mon héros, Adam Ingiliz. Adam ne cherche pas seulement un lieu sûr : il cherche un lieu où ses désirs et ses rêves puissent s’accomplir. C’est une quête différente.
On peut dire que ce sont les rêves et les désirs des exilés qui sont les véritables thèmes de ce nouveau livre.
En réalité, j’ai commencé à écrire sur l’exil en 2016. J’ai dans mon tiroir cinq livres de la même taille, sorte de courts romans (des novellas) sur la vie en exil, sur la complexité de cette vie, sur le fait qu’en exil, on n’est plus soi-même. On devient quelqu’un d’autre. J’ai donc repris ce thème et je l’ai développé dans cinq livres. Le Corbeau qui m’aimait est le premier de la série à avoir été traduit en français.
L’exil reste manifestement une expérience douloureuse pour vous ?
Je dirais que vivre en exil est une véritable tragédie. On est tiraillé entre ici et là, sans vraiment y être. Nous vivons dans un entre-deux, dans une sorte de limbe. En exil, je vis dans le souvenir de ma vie passée. Mes sensibilités, mes rêves, mon mode de vie, ma façon de penser, rien n’a vraiment changé. En réalité, seul mon corps est ici, mais mon âme, mon être tout entier, sont restés au pays. Vous savez, quand je suis arrivé en Europe, je n’étais plus très jeune : je suis arrivé avec une personnalité déjà structurée et une mémoire déjà construite. Je vis ici comme un visiteur. Je ne peux pas du jour au lendemain me glisser dans la tête d’un Français ou d’un Autrichien. C’est très difficile pour moi, parce que j’ignore la langue du lieu — non seulement la langue écrite ou parlée, mais aussi la langue des rues, la langue de l’histoire du pays, la langue de ses bâtiments. Vous savez, dans mon pays, quand je marche dans la rue de mon village, je sais quand tel bâtiment a été construit et par qui. Je connais intimement les rues, je sais à quoi elles ressemblaient avant. Quand je parle à quelqu’un, je le comprends avant même que nous ne commencions à parler, parce que je connais le contexte, je partage nos histoires communes qui nous relient. Il m’est très difficile de m’adapter aux « langages » des nouveaux lieux où je vis en exil. Je ne m’y sens pas à ma place, tout simplement parce que ni moi, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes arrière-grands-parents, n’ont participé à la création et au développement de cette culture. Je suis persuadé que le meilleur endroit pour vivre, pour un écrivain comme pour tout être humain, c’est son village, parmi sa famille, entouré de ses grands-parents, de ses amis, dans la proximité des tombes de ses ancêtres. C’est là que nous sommes faits pour vivre. Mais à cause des guerres qui ravagent nos pays, des situations politiques et sociales, des gouvernements qui nous enferment dans des identités étriquées, nous ne pouvons plus y vivre. Nous fuyons, nous nous réfugions dans des pays étrangers, où nous menons des vies empruntées, artificielles. Je crois que tout étranger est condamné à vivre des vies artificielles.
Pouvez-vous revenir sur les circonstances dans lesquelles vous avez été amené à fuir votre pays ?
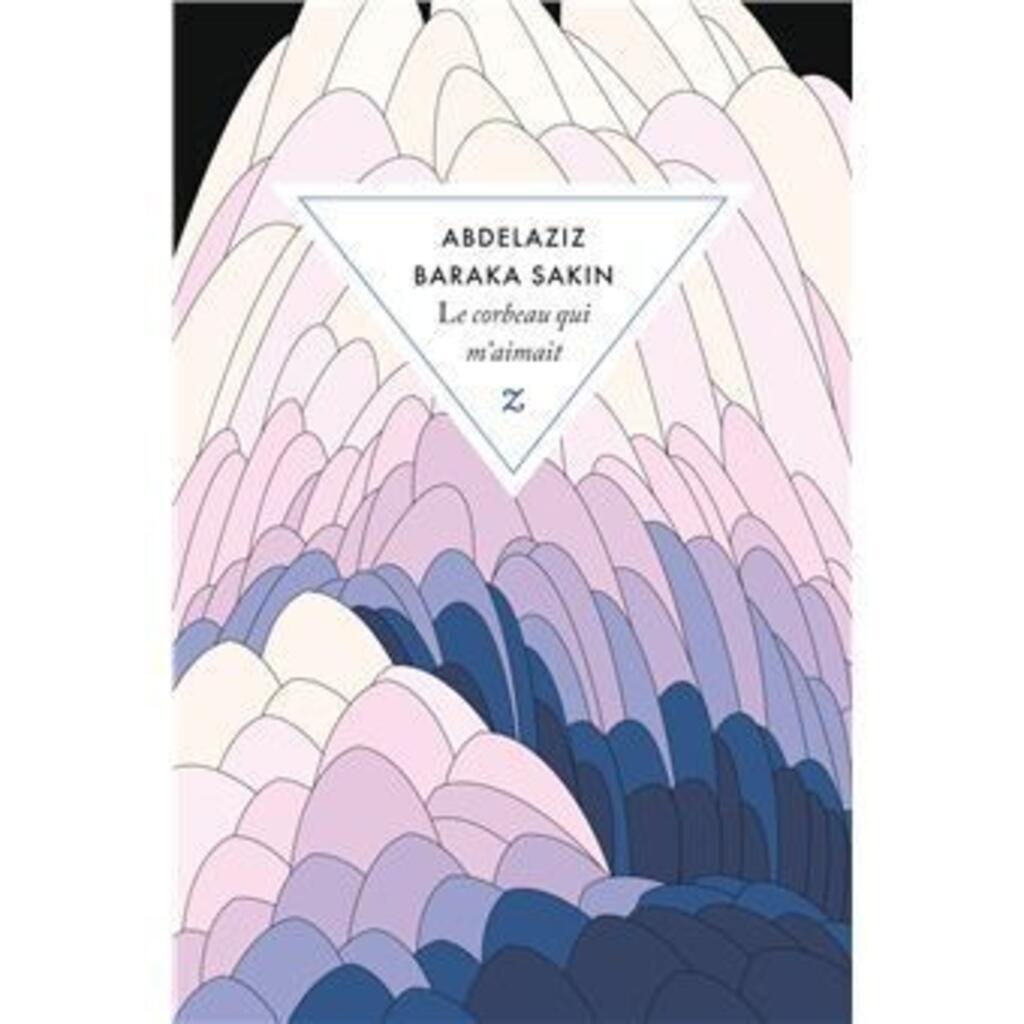
Je travaillais comme tout le monde. Puis, ils ont commencé à me harceler, à cause de mes livres. En 2009, ils ont confisqué tous mes ouvrages, qui ont été officiellement interdits, afin que personne ne puisse les lire. J’ai même signé une déclaration écrite acceptant que je ne publierais plus de livres. Je l’ai fait parce qu’au Soudan, on ne peut pas dire « non » aux agents de sécurité, il faut toujours leur dire « oui ». Ensuite, un très jeune officier de sécurité m’a prévenu que ma vie était en danger. Alors, j’ai pris la poudre d’escampette. Je suis d’abord parti en Égypte, puis en Autriche. J’ai passé plus de dix ans en Autriche. Ce fut difficile pour moi, de renouer avec ma vie d’antan, en tant qu’écrivain. En Europe, dans de nombreux pays, un réfugié est considéré d’abord comme un travailleur manuel. On ne vous reconnaît pas comme écrivain, comme quelqu’un qui peut penser ou faire autre chose. J’ai compris que l’écriture n’était pas considérée en Autriche comme un vrai métier. Alors je suis venu en France. J’y ai beaucoup d’amis, et j’ai reçu une aide financière du Centre national du Livre, ainsi que le soutien de nombreuses autres organisations. Aujourd’hui, je suis libre d’écrire. Je vis à Paris. Pour moi, je peux dire… la France est vraiment mon paradis.
Pourquoi les autorités soudanaises ont censuré vos livres ?
Au Soudan, l’identité pose un très grand problème. Selon la doctrine officielle du gouvernement, nous sommes un pays arabe et musulman. C’est une vision très réductrice, car si le pays compte effectivement des personnes d’origine arabe, il y a aussi d’autres musulmans, comme moi, qui sont d’origine africaine. Moi, je ne suis pas arabe. Dans mon pays, nous avons plus d’une centaine de langues, plus d’une centaine de groupes ethniques. Nous sommes véritablement un pays de diversité. Nous ne sommes pas une nation, mais plusieurs nations vivant côte à côte sur un immense territoire. Le gouvernement n’a pas su gérer cette diversité et a commis de grandes erreurs dès le début. À l’indépendance, en 1956, le premier président du Soudan, Ismaïl Al-Azhari, a déclaré, dès son discours d’ouverture : « Nous proclamons l’arabisation. » C’était une erreur. Dans mon livre Les Jango, j’ai essayé de mettre l’accent sur les identités distinctes des peuples du Soudan, les différentes religions qui coexistent dans le pays, les diverses manières de penser et d’être – cela n’a pas été apprécié.
Le Corbeau qui m’aimait est votre quatrième roman à être traduit en français, après Le Messie du Darfour, Les Jango et La Princesse de Zanzibar. Mais ce roman est différent. Il annonce l’avènement d’un nouveau monde, comme le nom de votre héros semble le suggérer. Il s’appelle Adam.
Le roman compte aussi un personnage féminin appelé Eva, ce qui correspond à Hawa en arabe. Elle est la première mère des êtres humains, comme Adam en est le père. Les noms sont significatifs dans mes récits. Je ne choisis jamais un prénom au hasard. Par exemple, l’autre grande figure féminine du livre s’appelle Zahra. Elle est l’amante d’Adam. En arabe, Zahra signifie « fleur ». La fleur est le symbole de la Nature : elle est en quelque sorte le tout premier être vivant apparu sur terre. Mon roman parle des fondements de la vie, des piliers de l’existence. Selon nos croyances religieuses, la vie a commencé avec Adam et Ève, mais d’après la science basée sur les faits réels, au début il y avait les fleurs.
Il y a un autre acteur important dans votre roman, c’est le « corbeau », qui a une valeur symbolique dans le livre. Mais sa dimension symbolique, voire fantastique n’est pas sans rappeler « Le Corbeau » d’Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire.
Vous savez, j’entretiens une relation privilégiée avec Edgar Allan Poe, son oeuvre. Le premier livre de littérature anglaise que j’ai lu dans ma vie, c’était Le Livre de la terreur et de l’horreur, de Poe. Depuis ce jour, Edgar Allan Poe est devenu une partie intégrante de mon écriture, et aussi – je peux dire – de ma vie. Quand j’ai commencé à écrire Le Corbeau qui m’aimait, des vers du poème The Raven d’Edgar Allan Poe me sont venus à l’esprit. J’aimerais profiter de cette occasion pour redire : "Edgar Allan Poe, je t’aime toujours".
C’est un bel hommage de l’Afrique à l’Américain Poe. Dans votre roman, cette symbolique du corbeau associée à la Jungle transforme en quelque sorte cet endroit en un lieu exceptionnel, bruissant de potentialités.
Comme je l’ai expliqué dans mon livre, dans la Jungle de Calais les réfugiés ont planté les germes d’une nouvelle communauté, d’une nouvelle vie – à condition que les autorités ne détruisent pas ce qui a été construit. Ce lieu est une maison pour les sans-droits, un foyer loin de leur foyer. Ils ont établi leurs propres lois, leurs propres règles, leur propre gouvernement. Ils ont même divisé l’espace entre Afghans, Soudanais et autres groupes ethniques. Pour moi, c’est comme un nouveau pays en train de naître, un lieu de refuge, pas seulement un banal point de passage vers l’Angleterre. C’est aussi un lieu de vie. On n’est plus dans les limbes.
Une dernière question, Abdelaziz Baraka Sakin, pour qui écrivez-vous ?
Pour ma mère. J’écris toujours et seulement pour ma mère. Elle est morte, elle s’appelait Maryam Bitt Abou Jibrin. Je veux qu’elle soit heureuse là où elle est. Elle est partie avec la conviction que son fils accomplirait de grandes choses. Voyez-vous, quand nous étions enfants, nous étions très pauvres. Elle se battait pour nous élever. Mon père est mort très jeune, et nous devions travailler dans les champs, sur les chantiers de construction – en fait, nous faisions n’importe quel travail que nous trouvions. J’étais très jeune à l’époque. Quand nous étions épuisés, accablés par les difficultés, elle me disait : « Demain, tu oublieras tout. » Alors j’écris pour elle. Mes vingt livres sont tous dédiés à Maryam, ma mère. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mais lorsque j’étais en Égypte ou ailleurs, à me battre pour vivre, et qu’un journal publiait quelque chose sur moi, ou que des gens lui disaient qu’un livre de son fils venait de paraître, ma mère allait acheter le livre ou le journal qui parlait de moi. Elle les gardait précieusement de côté pour me les montrer quand je revenais la voir.
(Propos recueillis par T. Chanda et traduits de l'anglais avec l'aide du Chat GPT)
Le Corbeau qui m’aimait, par Abdelaziz Baraka Sakin. Traduit de l’arabe par Xavier Luffin. Éditions Zulma, 168 pages, 18 euros.
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne